
Jean-François Arnaud 1953-2024, directeur artistique lumière
Jean-François Arnaud est né en 1953 à Suresnes en région parisienne. De 1973 à 1976, il suit l’École normale de Musique de Paris. Piano, harmonie et direction de chœurs, la mise en scène n’est pas loin. Pourtant, il enchaîne avec un DEUG d’Anglais à Nanterre, puis il est responsable de voile « croisière et compétition » de Mazura Marine pendant six ans à Boulogne. En parallèle, il aide son père Pierre Arnaud Chassy-Poulay sur de nombreux spectacles Son et Lumière en France et à l’étranger. Cette passion pour la mise en scène est plus forte que tous. En 1983, il devient directeur artistique de l’agence ECA – Études et Créations d’Ambiances. Alors, il apprend à travailler en équipe et à concevoir la lumière.
Directeur artistique lumière des villes
En 1989, ce metteur en scène convaincu crée la lumière dynamique pérenne pour le centre médiéval de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn. Une première en manière de conception lumière avec des lampes dichroïque halogène basse tension ! Pour cette réalisation, il recevra le 1er prix 1992 du Concours « Lumière et Monuments » du SERCE. Mais aussi, pour la mise en lumière du Palais des Beaux-Arts de Lille, l’IIDA Waterbury Award of Distinction 1998 of Outdoor Lighting aux États-Unis, décerné par l’IES – Illuminating engineering society.
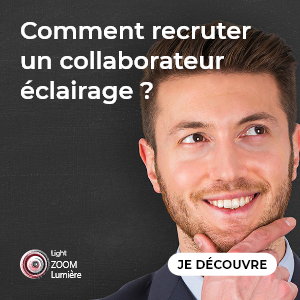
À partir de 1995, il devient directeur artistique lumière pour la ville de Colmar et met en place le procédé KSL, le Kit Son et Lumière. Au fil des ans, il réalise avec le concepteur lumière Duilio Passariello plusieurs mises en lumière dynamique sous le titre de « Nocturnales ». Objectif : créer des animations nocturnes des villes et des sites avec de l’éclairage architectural. En 1996, il rejoint Citelum en tant que directeur artistique et responsable du secteur Lumière dynamique et Son et Lumière. C’est alors qu’il fonde le département « Clair-Obscur » et réalise de grands spectacles événementiels.
En 2001, il reprend son indépendance en tant que conseiller artistique et metteur en scène. C’est l’un des seuls à exercer, à plein temps et de manière indépendante, la direction artistique lumière. Il le sera notamment pour la ville d’Orléans pendant plusieurs années.
- A lire aussi : Virginie Voué, 15 ans de Luminescence
Enfin, en janvier 2012, il crée, avec son fils Thibault Arnaud, l’Atelier du Son et Lumière avec la devise des Dominicains « contemplare aliis tradere », contempler et transmettre aux autres.

Précurseur de la lumière dynamique pérenne
Lors de la rédaction de mon livre Lumières architecturales en France, j’ai eu l’occasion d’échanger avec Jean-François Arnaud. Il a été d’un des précurseurs de la profession de concepteur lumière, notamment en éclairage dynamique pérenne. A suivre ci-dessous quelques citations recueillis lors de nos échanges sur ses réalisations de Cordes-sur-Ciel, Lille, Chambord et Colmar. Elles sont toutes parues dans cet ouvrage rétrospectif.
A l’occasion de mon article sur le métier de directeurs artistiques lumière en France, paru dans la revue PLD – Professionnal lighting design, j’avais pu l’interviewer plus directement. Il décrivait une partie de son parcours, mais aussi les qualités et les limites de ce métier. Dans cet hommage à l’homme pour qui le patrimoine et la lumière avait un sens, relisez ce témoignage ci-dessous.
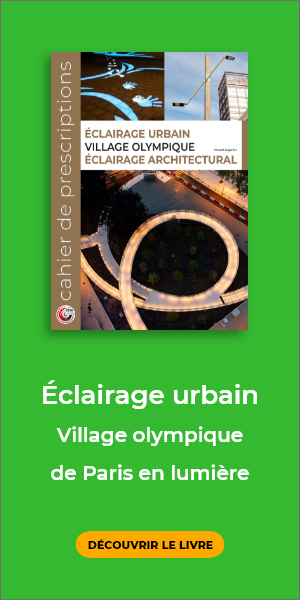
Sommaire
- Directeur artistique lumière des villes
- Précurseur de la lumière dynamique pérenne
- Centre médiéval, Cordes-sur-Ciel, Tarn
- Les Nocturnales, palais des Beaux-Arts, Lille
- Les Nocturnales, château de Chambord
- Les Nocturnales, centre historique, Colmar
- Interview pour l’article de la revue PLD : Art director for lighting
- Château de Saint-Germain-en-Laye
- Le Phénix, théâtre de Valenciennes
- Approfondir le sujet
- Commentaires
Centre médiéval, Cordes-sur-Ciel, Tarn
- Concepteurs lumière : Pierre Arnaud et Jean-François Arnaud
- Juin 1989
Les façades gothiques des maisons du XIVe siècle de Cordes-sur-Ciel sont une de ces attractions patrimoniales. En grès rose sombre, elles se distinguent notamment par leurs arcades et des fenêtres jumelées, souvent ornées de colonnettes. Parfois surmontées de rosaces, ces baies présentent une décoration riche de chapiteaux sculptés de feuillages et de visages.

Le comité de communes du pays Cordais prévoit une animation nocturne dans le centre-ville, visant à attirer l’attention et créer une ambiance agréable. En 1988, un appel à projet a été lancé, et l’équipe des concepteurs lumière Pierre et Jean-François Arnaud d’ECA a été sélectionnée. À la manière d’un spectacle, leur proposition consiste en une mise en lumière dynamique de la vieille ville. Le choix des sites vise à constituer un jalonnement lumineux selon le concept décrit par Pierre Arnaud : « D’un monument, on percevra toujours le suivant ».

Les monuments sont éclairés directement depuis leurs façades à l’aide de petits projecteurs installés sur les appuis de fenêtres, ce qui permet de mettre en valeur des détails architecturaux. Équipés de lampes halogènes dichroïques à basse tension, ces projecteurs passent inaperçus durant la journée. Bien que le coût d’installation soit plus élevé en raison de la multiplication des appareils, la consommation électrique reste comparable à une solution classique. Développés en collaboration avec un architecte des Monuments Historiques, les projecteurs sont placés de part et d’autre des baies pour mettre en lumière les chapiteaux sculptés. Des appareils encastrés dans le sol éclairent les arcades des rez-de-chaussée, tandis que des lanternes au sodium blanc assurent la continuité du parcours tout en harmonisant l’éclairage.

La programmation provoque une respiration toutes les 30 minutes de l’ensemble des façades. Jean-François Arnaud précise : « Pendant une première variation très lente sur 30 secondes, la lumière passe à 20 % puis retourne à 40 %, permettant ainsi de remarquer la modification. Dans la foulée, la même séquence est renouvelée à deux reprises, respectivement sur 15 et 7 secondes, pour permettre d’observer l’effet de lumière. Le dernier état est maintenu à 100 % pendant 1 minute pour faire des photos, mais surtout pour le recyclage de l’halogène et pour augmenter la durée de vie d’environ 4 000 heures. »
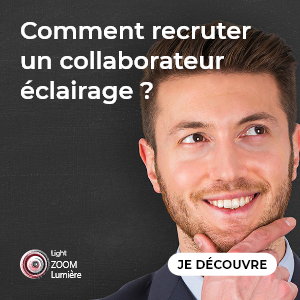
Les Nocturnales, palais des Beaux-Arts, Lille
- Concepteurs lumière : Jean-François Arnaud et Duilio Passariello
- Juin 1995
Fin 1991 débute la rénovation intérieure du Palais des Beaux-Arts de Lille conduite par les architectes Ibos et Vitart. Le musée, passant de 17 000 à 22 000 m2, devient le deuxième de France après le Louvre. Pour marquer cet événement, en juillet 1994, la Ville de Lille organise un concours ouvert portant sur la mise en lumière de trois façades seulement, la quatrième donnant sur le nouveau bâtiment en verre qui renvoie l’image du palais ne fait pas partie de la compétition. Tout en révélant les volumes, les concepteurs lumière Jean – François Arnaud et Duilio Passariello donnent des perceptions différentes du monument au fur et à mesure de l’avancée de la nuit. Il ne s’agit pas d’un spectacle lumineux que l’on regarde, mais d’une relecture de la composition architecturale par l’usage de la palette des contrastes négatifs et positifs. La façade principale change ainsi lentement d’aspect grâce à des effets de contre-jour qui révèlent les silhouettes des balustrades et des colonnes, et d’un éclairage rasant qui souligne les chapiteaux et les corniches.

« La séquence comporte deux tableaux principaux et trois mouvements. Un tableau est une illumination qui dure un certain temps. Principalement une vue statique, à laquelle peuvent venir s’ajouter des éléments dynamiques. Un mouvement est une séquence dynamique de fondu enchaîné lumineux ou de mise sous ou hors tension de l’éclairage » expliquent les concepteurs. Seules les façades latérales pleines sont éclairées par un plein feu doux et statique en bain de pied. La subtilité de cette variation sur un quart d’heure réside aussi dans l’intégration des caractéristiques propres des sources lumineuses utilisées. Par exemple, la montée progressive à 100 % des lampes halogènes sur gradateur atténue l’extinction des lampes à décharge sur interrupteur.
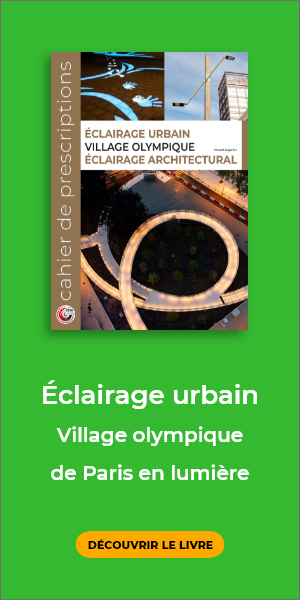
Les Nocturnales, château de Chambord
- Concepteur lumière : Jean-François Arnaud
- Juillet 1995
En 1995, Vincent Valère, chargé de mission Lumière à la Caisse nationale des monuments nationaux et des sites – Cnmns –, fait expertiser l’état des anciens appareils du château de Chambord. Le concepteur lumière Jean-François Arnaud est ensuite sollicité pour créer une animation lumineuse utilisant, si possible, le matériel existant. L’idée est d’accompagner la promenade nocturne, explique le concepteur, par une série d’effets discrets, permettant de découvrir l’architecture et la majesté du château.
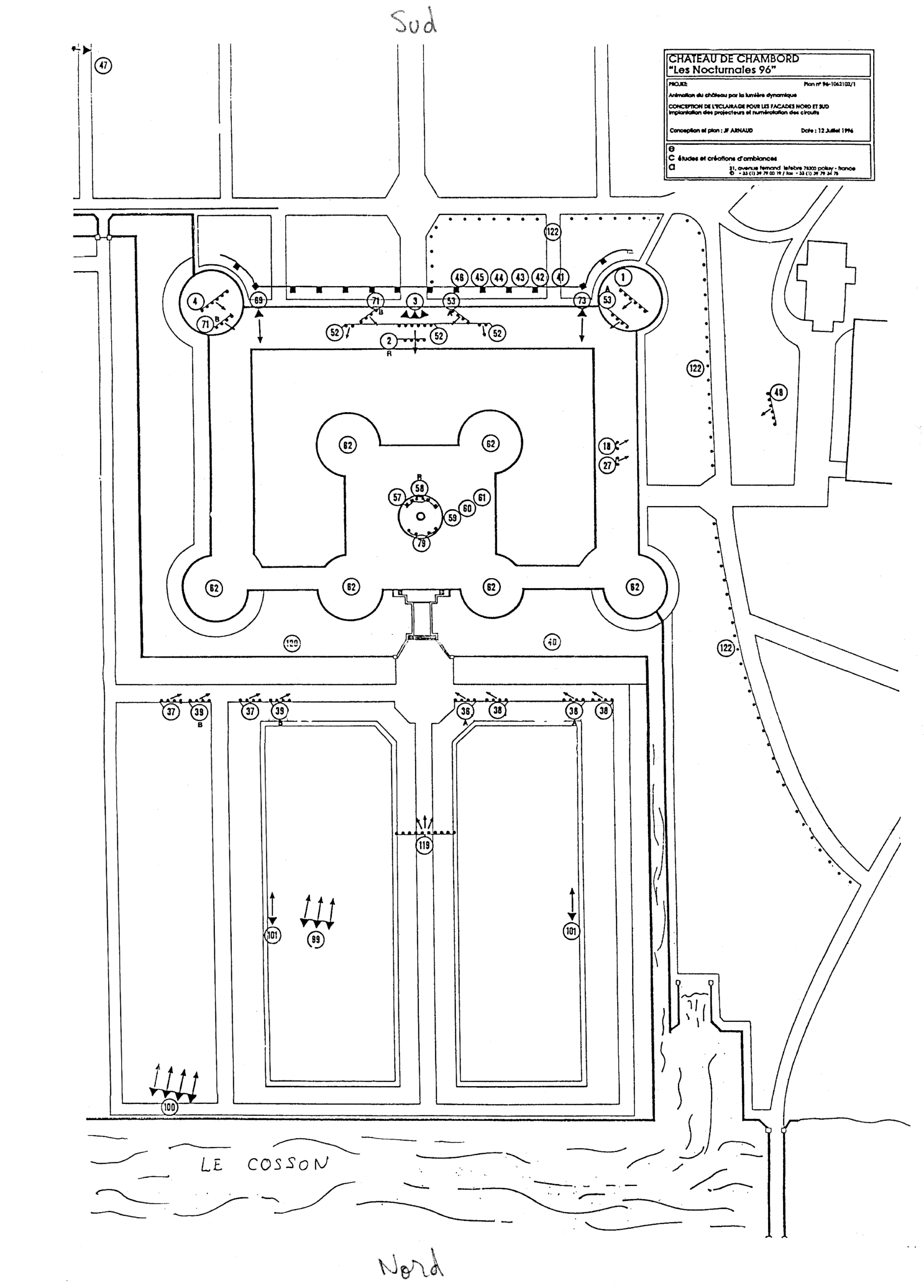
Alors que le visiteur pressé ne verra qu’un état des éclairages, le flâneur, celui qui prend son temps, pourra profiter toute la soirée dans le parc des différentes images du château, tantôt mystérieux, tantôt grandiose, triste ou gai, discret ou immense. En ce sens, la lumière se veut simple, naturelle, les ombres ont le temps de tourner, d’apparaitre et de disparaître lentement.
Le choix des couleurs suit la course de notre astre solaire sur une journée jusqu’à la lumière si particulière de la lune, comme le présente Jean-François Arnaud : « bleu = blanc froid lunaire, installé à l’est du château ; ambre = orangé du coucher du soleil, installé à l’ouest du château ; rouge = fin des rayons au coucher du soleil (effet marié avec le blanc et l’ambre) ; blanc chaud = couleur de la pierre (lampes à incandescence) ; blanc froid = blanc bleuté pour le contre-jour, permettant un halo découpant le château, ou un blanc intense de plein feux sur la façade éclairée. »
Pour réveiller la poésie du site, la symétrie des circuits de l’installation initiale est supprimée, les projecteurs re-réglés et les gélatines remplacées par des verres teintés.

Vincent Valère : « Comme le marché du matériel d’éclairage architectural d’occasion n’existait pas en France, j’ai choisi de faire réaliser une mise en lumière dynamique permanente. Coût ? 45 734 Euros (honoraires du maître d’œuvre et frais de bureau d’étude). Le précédent spectacle avait coûté 2,28 millions d’Euros. »
Les Nocturnales mettent en œuvre des effets lumineux simultanés qui s’enchaînent très lentement sur les deux façades principales et opposées. Toute la complexité de la programmation informatique sur 30 minutes a résidé dans le fait que la séquence est toujours visible quelle que soit la position du public, un contre-jour vu du nord est un plein feu côté sud.

Les Nocturnales, centre historique, Colmar
- Concepteurs lumière : Jean-François Arnaud et Duilio Passariello
- Octobre 1997
En octobre 1995, une consultation restreinte a lieu pour la direction artistique et la création des éclairages du centre historique de Colmar. Les concepteurs lumière, Duilio Passariello et Jean-François Arnaud, désignés lauréats, partent de la richesse architecturale diurne et de la convivialité du secteur sauvegardé. Pour créer une ambiance nocturne douce et fine sans tout illuminer, leur p re m i è re tâche va être de sélectionner les éléments à mettre en lumière : les façades, les arbres, les monuments, les statues, l’eau. Six zones vont ensuite être définies avec chacune un élément « phare » situé au cœur d’un « faubourg de la lumière », constituées de rues, ruelles et façades isolées. Chaque ambiance utilise une lumière colorée qui est associée à un thème précis, alors mis en scène par les concepteurs : « Bleu pour l’air, généralement placé en éclairage des toitures ; vert pour l’eau, soit en bordure de rivière, soit dans une zone où l’eau n’est pas vue mais existe ; ambre ou jaune pour la terre, souvent dans les branches des arbres ; blanc chaud (2 700 K) pour le feu, principalement sur les maisons à colombages ou derrière les volets. »

L’originalité de l’installation est de graduer en dynamique près de la moitié des 600 appareils d’éclairage par un ordinateur situé à distance. Les séquences d’effets lumineux sur les bâtiments s’enchaînent en fondu, très lentement, pendant quelques minutes. Cette performance technique à l’échelle d’une ville a été rendue possible grâce au réseau fibre optique, couramment utilisé pour la télévision, qui parcourt 90 % de la surface de la commune. Ce choix proposé par les concepteurs et l’entreprise Concept Light a été retenu par la Régie municipale de Colmar, aujourd’hui Vialis, exploitant du réseau câblé.
Selon les exigences du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, les câbles ont été dissimulés au maximum par l’installateur, par exemple derrière de nombreuses descentes d’eau pluviale, les appareillages étant placés en toiture. Devant le refus des projecteurs en façade, une création d’encastrées de sol spécifiques, équipées de trois lampes dichroïques xénon sur circuit séparé, sont implantées.

Afin de garder un caractère événementiel, les illuminations sont seulement visibles les vendredis et samedis et à d’autres occasions festives. Ainsi, elles donnent à la ville une poésie qui anime le patrimoine en favorisant sa redécouverte nocturne.
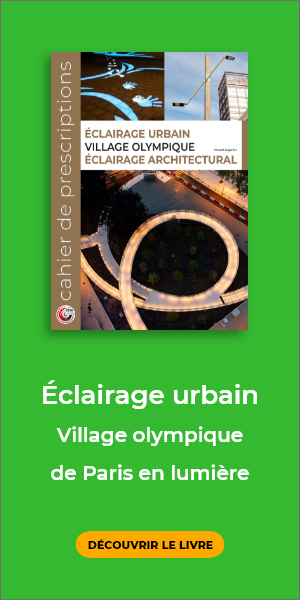
Interview pour l’article de la revue PLD : Art director for lighting
- Extrait de l’article Art director for lighting de Vincent Laganier.
- Paru dans PLD magazine, n° 33, octobre 2003, page 32-39.
- Rédacteur en chef : Joachim Ritter « En éclairage extérieur, la France est le leader mondial »
- Interviews de six professionnels de l’éclairage vers une nouvelle discipline de directeur artistique lumière : Vincent Valère, Josy Bibes Froment, Roger Narboni, Jean-François Arnaud, Nathalie Gouraud et Tracy Eck.
Quel a été votre rôle chez Citélum de 1996 à 2001?
Jean-François Arnaud : Mon travail consistait à développer la lumière dynamique. J’étais directeur artistique et pilotais le bureau d’étude de l’entreprise sous la responsabilité du directeur technique. L’équipe que j’animais, d’une moyenne d’âge de 25 ans, avait cinq à six ans d’études et/ou d’expérience derrière le baccalauréat. Ils étaient tous spécialisés dans la lumière, la conception ou le design, avec un réel savoir-faire, mais peu d’expérience du terrain.
Au début, il s’agissait d’abord de leur montrer le maximum de choses in situ. Sur les projets de Colmar, Valenciennes et Rio de Janeiro, nous avons travaillé en plusieurs équipes de deux personnes, analysant d’abord, l’évolution des éclairages, puis en déduisant des principes qui seraient utilisés ou non dans leurs propres futurs concepts.

- A lire aussi : Paris Treize ponts en illumination intégrée
Ensuite, j’étais à leur disposition pour les questions qu’ils se posaient sur les projets dont ils avaient la charge. Je devais accepter que les concepts ne viennent pas de moi – ce qui est frustrant au départ pour un concepteur – et laisser à chacun l’argumentation de son point de vue. J’effectuais un contrôle global du dossier, sans critique du concept s’il était réaliste, en attirant leur attention sur les grandes options artistiques et techniques au regard du coût. Par exemple, un projecteur asservi extérieur devient vite un véritable produit miracle pour un jeune concepteur, or il y a plein d’autres solutions simples pour réaliser le même effet, sinon mieux. Son utilisation doit se faire avec parcimonie à l’endroit où il est incontournable pour la qualité de l’ambiance. Les techniques évoluant très vite, on doit savoir les utiliser à bon escient, car très vite, les limites de la conception sont régies par le budget d’investissement et les coûts de maintenance !

En 2003, comment travaillez-vous à Orléans ? Initiez-vous toujours vos équipes à la pratique de la lumière ?
Jean-François Arnaud : Sur la Ville d’Orléans, ECA et TUP – Thébaud Urba Paysage – ont remporté un appel d’offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage. J’assure la direction artistique de l’équipe formée des services techniques (illumination et éclairage public) et leurs stagiaires. À l’issue d’essais et d’un travail sur le terrain, ils réalisent des documents projets, rue par rue. Ces documents rassemblés constitueront petit à petit un « plan lumière pratique. » Chaque rue est réalisée dans les six à huit mois qui suivent le document. Ma mission de directeur artistique est alors d’assurer la cohérence de qualité de la lumière au fur et à mesure de l’avancement du projet global.
De manière générale, c’est en montant une équipe aux compétences multiples, avec tous les savoir-faire, que l’on peut véritablement former des gens. Une fois l’équipe locale montée, il nous faut aussi prendre en compte les enseignes, les revêtements de sol, etc. Dans ma direction artistique, le client fait partie intégrante de l’équipe ! Ainsi, contrairement à certains de mes confrères, je ne commence pas par vendre du papier, mais du concret. Par exemple, à Colmar, le plan lumière n’a pas été fait sur papier mais, d’abord, sur la nacelle.

Quelle sont les qualités pour être directeur artistique lumière ?
Jean-François Arnaud : Je suis convaincu qu’indépendamment de l’âge, il faut avoir une pratique d’une dizaine d’années derrière soi. Par ailleurs, il est nécessaire de savoir travailler en équipe, ce qui n’est pas toujours évident pour un indépendant. Il faut ne pas avoir peur d’impliquer les gens et de leur faire confiance. Cette expérience doit inclure une pratique commerciale car, tout artiste doit savoir vendre son art, transmettre son enthousiasme, se risquer parfois à aller à contre-courant et innover, sinon ses idées ne passeront pas le seuil du papier ! Enfin, il faut du bon sens et savoir prendre du recul. C’est le même travail de coach que celui d’un entraîneur de football ! C’est quelqu’un qui connaît le foot, qui donne une bonne orientation aux joueurs et sait les motiver. C’est du management !
Pour vous quelles sont les limites d’un bon directeur artistique lumière ?
Jean-François Arnaud : Dans mon travail, il n’y a aucune limite, si ce n’est le bon goût de l’équipe et la compréhension de la demande du « client » ! Je me vois plutôt comme un impressionniste, que comme un peintre classique. Ma vision globale, c’est celle d’un mécano que je construis, différemment chaque jour. Dans la vie, c’est ainsi : tout change en permanence. Ces dernières années, on a donné trop d’importance au concept lumière au détriment de l’ambiance finale. Pourtant, la lumière n’est qu’une composante de l’ambiance avec le climat, les saisons, les nuisances sonores et lumineuses et le bâti de la ville. Pour moi, ce qui importe, ce n’est pas de savoir si mon concept est réussi, mais si le noctambule trouve que “ c’est beau la nuit ”, sans savoir nécessairement pourquoi. Bien sûr, il faudra toujours des dossiers et des créateurs lumière indépendants, divers et variés. Je crois que le métier de concepteur lumière est indispensable à la qualité du projet, alors que celui de directeur artistique lumière l’est à la cohérence de sa réalisation.
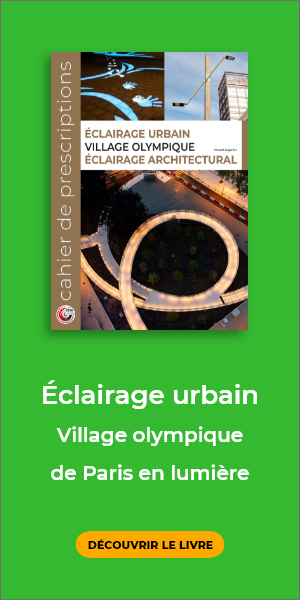
Château de Saint-Germain-en-Laye
- Conception Lumière : Steff Grivelet et Jean-François Arnaud
Jean-François Arnaud : le rôle du directeur artistique lumière c’est aussi de trouver de nouvelles idées de communication pour présenter des concepts lumière comme, par exemple, fin 2001, la plus grande infographie du monde… à l’échelle 1. L’innovation permettait de gagner un temps énorme entre le politique et la population. Nous avons montré aux habitants comment serait le château une fois éclairé en simulant cette illumination par des images géantes. L’enthousiasme suscité permet à la Mairie d’imaginer l’avenir sereinement.

Le Phénix, théâtre de Valenciennes
- Conception Lumière : Marc Lizee, Citélum
- Architecte : Emmanuel Blamont et Lou Caroso
Jean-François Arnaud : dans l’appel d’offre pour la gestion de l’éclairage urbain de Ville de Valenciennes, il y avait 60 sites à éclairer. La demande de l’entreprise était de coordonner et de valider les projets. En tant que directeur artistique, j’avais choisi 5 concepteurs lumière : trois de Citelum et deux de l’ACE. Cette mise en lumière du théâtre a été conçue de manière complètement différente de celle que j’aurais personnellement réalisée, mais avec des principes de lumière dynamique identiques à mes précédentes réalisations à Lille ou Chambord. C’est un bon exemple de transmission de savoir-faire qu’on doit à la nouvelle génération de concepteurs lumière.

Approfondir le sujet
- Un Son et Lumière à la collégiale Notre Dame de Poissy
- Conception lumière : rétrospective du métier et ses publications
- Pierre Bideau 1941-2021 : hommage à l’éclairagiste
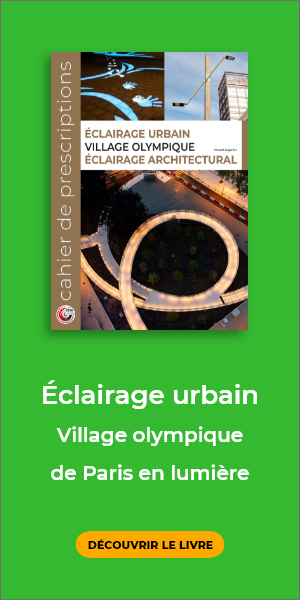
Photo en tête de l’article : Jean-Francois Arnaud, directeur artistique, metteur en scène et concepteur lumière – portait © ECA


