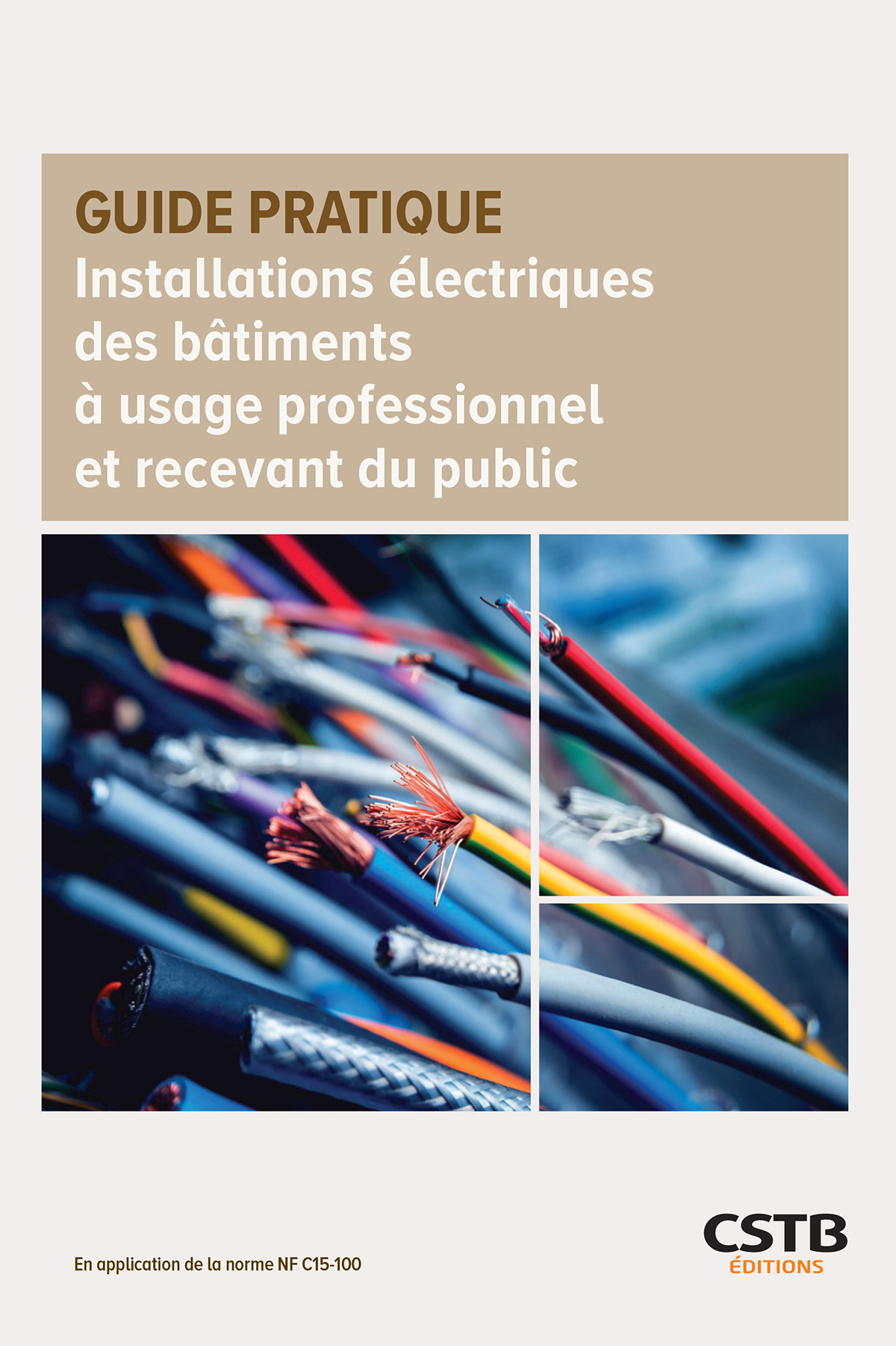Christophe Martinsons : lumière, santé et normes
Quel a été votre parcours ?
Christophe Martinsons : Je suis physicien de formation. J’ai réalisé ma thèse à l’université de Reims Champagne-Ardenne, où j’ai travaillé sur l’utilisation de méthodes optiques appliquées à la thermique des matériaux. Par la suite, j’ai passé deux ans, autour de l’an 2000, au National Physical Laboratory (NPL), l’institut national de métrologie du Royaume-Uni. J’ai rejoint le service R&D d’Atral, fabricant de systèmes d’alarme qui sera ensuite intégré au groupe Hager, où j’ai travaillé pendant sept ans comme ingénieur opticien spécialisé dans la détection infrarouge thermique.
Concrètement, sur quoi portait votre travail dans cette entreprise ?
Christophe Martinsons : Je m’occupais en grande partie de la conception optique des lentilles de Fresnel pour les détecteurs infrarouges. Le matériau imposé était le polyéthylène : c’est pratiquement le seul qui soit très bon marché et qui laisse passer un minimum de rayonnement pour des longueurs d’onde autour de 10 µm, mais il reste très absorbant. D’où l’intérêt des lentilles de Fresnel, dont la faible épaisseur, environ 0,5 mm, limite les pertes tout en permettant de focaliser correctement le signal.
La fabrication se réalise ensuite par injection plastique, à partir de moules usinés au diamant avec une grande précision. Aujourd’hui, près de 90 % des détecteurs infrarouges du marché utilisent toujours ce principe.

Quels étaient vos premiers chantiers au CSTB ?
Christophe Martinsons : J’ai rejoint le CSTB à Grenoble à un moment charnière, en 2007, alors que les LED commençaient à s’imposer face aux sources lumineuses traditionnelles. Tout était à inventer : il fallait concevoir des bancs de mesure adaptés à ces nouvelles technologies. Nous avons mis en place des sphères d’intégration de différentes tailles, des spectroradiomètres modernes pour analyser finement le spectre lumineux, un goniophotomètre pour mesurer la distribution angulaire de la lumière, ainsi que des alimentations électriques stabilisées et des analyseurs de réseau, car la qualité de l’alimentation influe fortement sur les performances d’une LED.

En parallèle, nous avons lancé plusieurs projets collaboratifs, financés par l’ANR, l’ADEME et d’autres programmes nationaux, pour définir des méthodes de caractérisation électrique et photométrique robustes. L’objectif était clair : fournir aux acteurs du bâtiment des outils fiables pour intégrer correctement les LED dans leurs projets.
Quels étaient les principaux enjeux de métrologie avec les premières LED ?
Christophe Martinsons : Il y avait deux grands types de difficultés. D’une part, les mesures photométriques – la quantification du flux lumineux émis et de sa distribution angulaire – nécessitaient des protocoles et des équipements adaptés aux LED, souvent petites ou avec des optiques intégrées. D’autre part, les mesures électriques présentaient des incertitudes importantes : la qualité de l’alimentation, en termes d’impédance, de distorsion harmonique ou de bruit, pouvait fausser la mesure de la puissance consommée et donc l’efficacité lumineuse (le fameux lumen par watt). Des erreurs jusqu’à 10 % étaient observées si l’alimentation de test n’était pas parfaitement contrôlée. Ces travaux ont ensuite été repris dans les recommandations et normes internationales, notamment dans les documents CIE sur les caractérisations électriques et photométriques des LED. En résumé, pour mesurer correctement une LED, il faut maîtriser à la fois la partie optique et la partie électrique.
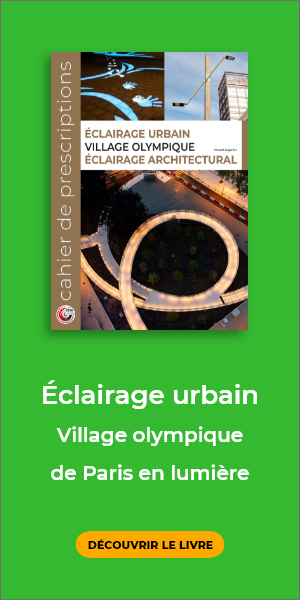
Que retenir de vos travaux sur la « lumière bleue » ?
Christophe Martinsons : J’ai collaboré avec l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de plusieurs expertises, pour évaluer les risques sanitaires liés à la lumière bleue émise par les LED. Ces travaux ont abouti à trois rapports majeurs : le premier en 2010 sur les risques photobiologiques des LED, le second en 2019, actualisant les connaissances sur les effets de la lumière bleue sur la santé humaine et l’environnement, et le troisième en 2024, portant sur les risques des LED utilisées dans les jouets pour les yeux des enfants.

Il faut faire la différence entre deux phénomènes souvent confondus. D’un côté, il y a le risque phototoxique rétinien, qui concerne les longueurs d’onde bleu-violet, autour de 430 nm. Avec certaines LED mal conçues, très lumineuses et sans diffuseur, les niveaux pouvaient être préoccupants. Depuis, la réglementation s’est renforcée, mais certaines populations sensibles, comme les enfants ou les personnes avec des troubles visuels, ne sont pas encore prises en compte dans les normes de sécurité.
De l’autre côté, il y a l’effet d’entraînement du rythme circadien, lié à la lumière autour de 480 nm, qui active des cellules ganglionnaires à mélanopsine et influence la sécrétion de mélatonine et le cycle veille-sommeil. Ce n’est pas toxique, mais cela représente un vrai enjeu pratique : s’exposer le soir à une lumière riche en bleu retarde l’endormissement. Les recommandations récentes, de la CIE et d’autres organismes, suggèrent d’avoir une lumière suffisamment stimulante dans la journée et très faible le soir et la nuit, idéalement moins de 1 lux dans le plan de l’œil. L’idée essentielle, c’est le contraste jour/nuit, plutôt que le simple niveau absolu de lumière.
Quel est votre rôle aujourd’hui au CSTB ?
Christophe Martinsons : Aujourd’hui, je mène des études à Grenoble au sein du laboratoire d’éclairage. On y fait à la fois de la recherche, souvent dans le cadre de projets nationaux et internationaux, et des prestations d’essais pour les industriels ou les maîtres d’ouvrage : mesures photométriques, tests électriques, vérification de capteurs ou de systèmes de détection, etc.

Le CSTB joue vraiment un rôle de pont entre la recherche et le terrain. Les résultats de nos travaux servent à faire évoluer les normes, les certifications et, à terme, la réglementation du bâtiment. Notre laboratoire n’est pas dimensionné pour du test industriel de masse, mais il permet de mener des campagnes de mesure fiables, de soutenir la R&D et d’apporter une expertise reconnue dans les instances de normalisation.
Quel est votre thème de recherche principal ?
Christophe Martinsons : Depuis plusieurs années, je m’intéresse principalement aux effets de la modulation temporelle de la lumière. Derrière ce terme un peu technique, trois phénomènes se distinguent : le flicker (le papillotement visible), l’effet stroboscopique et les images fantômes.
Ces travaux s’appuient sur des programmes européens de métrologie, et donnent lieu à la fois à des publications scientifiques et à des propositions normatives pour mieux encadrer ces phénomènes.
Qu’est-ce que le flicker et pourquoi s’en préoccuper ?
Christophe Martinsons : Le flicker, c’est le papillotement à faible fréquence d’une source lumineuse, visible même quand on ne bouge pas les yeux. On le mesure à l’aide d’indices de modulation temporelle (il en existe plusieurs) qui permettent de quantifier les variations d’intensité lumineuse. Ces fluctuations peuvent venir de la source elle-même, mais aussi, très souvent, de la qualité de l’alimentation électrique.
Le flicker est aujourd’hui associé à des lampes LED défectueuses ou à des perturbations de courant. Il peut entraîner de l’inconfort visuel, des maux de tête et, chez des personnes sensibles, déclencher certains troubles. Sur le plan métrologique, il est essentiel de caractériser les lampes dans des conditions électriques contrôlées, afin de bien distinguer ce qui relève du défaut intrinsèque du produit et ce qui est dû à l’alimentation électrique.
Qu’est-ce que l’effet stroboscopique et quelles sont ses conséquences ?
Christophe Martinsons : L’effet stroboscopique se produit lorsque des mouvements sont « décomposés » par une modulation temporelle de la lumière à certaines fréquences, généralement à 100 Hz (après redressement du 50 Hz). Concrètement, un objet en mouvement peut sembler immobile ou présenter une trajectoire saccadée, ce qui représente un danger pour la perception du mouvement, notamment autour des machines, dans des escaliers ou sur la route, et constitue une gêne dans les environnements de travail. Nos travaux psychophysiques et métrologiques ont contribué à la révision de la réglementation européenne des lampes et luminaires, en introduisant des valeurs limites pour l’effet stroboscopique dans des textes récents. C’est un exemple de recherche ayant eu un impact rapide et marquant sur les normes.

Qu’est-ce que l’effet de « réseau fantôme » et comment se manifeste-t-il ?
Christophe Martinsons : L’effet de réseau fantôme, ou images fantômes, apparaît à des fréquences de modulation élevées (à partir de 200 Hz jusqu’à quelques kilohertz) et se manifeste lors de saccades oculaires rapides par l’apparition d’une série d’images persistantes de la source lumineuse. Il touche principalement la vision fovéale, conservant les couleurs et les contours fins. Ce phénomène est particulièrement visible sur des fonds sombres, par exemple les phares de voiture la nuit, certains affichages LED ou les bornes de recharge utilisant la gradation PWM (modulation de largeur d’impulsion, souvent vers 400 Hz). Nous avons développé des protocoles psychophysiques pour quantifier la perception humaine de cet effet et produire une courbe de sensibilité qui vient d’être publiée. Bien que l’éclairage public, grâce à des drivers et gradateurs adaptés, évite généralement ces fréquences problématiques, le phénomène reste critique pour de nombreuses autres lumières urbaines ainsi qu’en éclairage intérieur.


Quelles sont vos prochaines pistes de recherche ?
Christophe Martinsons : Nous explorons désormais un axe lié au changement climatique et à la santé : l’impact des vagues de chaleur sur notre exposition à la lumière. De manière contre-intuitive, pour nous protéger du soleil pendant les vagues de chaleur, nous passons davantage de temps à l’intérieur, parfois dans l’obscurité ou sous un éclairage purement artificiel, ce qui modifie la synchronisation de l’horloge biologique. Ce phénomène amplifie les effets négatifs de la chaleur en perturbant le sommeil et certaines fonctions métaboliques. L’enjeu de nos travaux est donc de mesurer concrètement ces modifications d’exposition et de concevoir des solutions d’éclairage et des architectures qui concilient confort thermique, protection solaire et maintien d’une lumière bénéfique pour la santé.
Vous êtes président de la CIE France. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit ?
Christophe Martinsons : La CIE, Commission internationale de l’éclairage, est l’organisation mondiale de référence en matière de lumière et d’éclairage. Elle élabore des normes, rapports techniques et recommandations qui servent de base scientifique et réglementaire à l’échelle internationale. La CIE France en est la section nationale : elle réunit chercheurs, industriels, organismes publics et spécialistes de la santé, et sert de relais pour les contributions françaises aux travaux internationaux.
Quelles sont les missions concrètes de la CIE France et en quoi consiste votre rôle de président ?
Christophe Martinsons : Nous animons un réseau d’une soixantaine d’adhérents, organisons une à deux conférences par an, coordonnons les relectures et votes sur les documents de la CIE et facilitons la diffusion des normes et rapports. En tant que président, je coordonne ce fonctionnement et j’anime le bureau qui regroupe les représentants des divisions de la CIE :
- D1 : Vision et couleur,
- D2 : Mesure de la lumière et du rayonnement,
- D3 : Éclairage intérieur et conception d’éclairage,
- D4 : Transport et applications extérieures de l’éclairage,
- D6 : Photobiologie et photochimie,
- D8 : Technologies de l’image.
Je veille à ce que la France soit active dans les différents groupes de travail, où les votes nationaux influencent directement le contenu des textes internationaux.
Pour illustrer cette activité, la CIE France a animé une série d’ateliers interactifs sur les caractéristiques de la lumière pour la première fois aux Journées nationales de la lumière, à Paris. Les participants ont pu explorer la température de couleur, l’indice de rendu des couleurs, la modulation temporelle de la lumière, l’uniformité lumineuse, l’éblouissement et les effets sur le confort visuel et la santé.

Quels sont les points forts de la recherche française en éclairage ?
Christophe Martinsons : La France se distingue par la diversité de ses acteurs : laboratoires universitaires, établissements publics comme le CSTB ou le Cerema, industriels nationaux et fabricants d’instruments de mesure. Les spécialistes de la santé – biologistes, chronobiologistes, médecins du sommeil – y sont de plus en plus présents, ce qui permet de relier métrologie, éclairage et applications sur la santé.
Sans être exhaustif, on peut citer parmi les contributions françaises remarquables : la métrologie de l’apparence, la photométrie des revêtements routiers, la colorimétrie des LED, l’étude de l’éblouissement, ainsi que la photobiologie et l’effet de la lumière sur les rythmes circadiens. Cette pluralité d’expertises se traduit par une présence active dans toutes les divisions principales de la CIE. La France est actuellement représentée au comité de direction de la CIE par Noël Richard, en tant que président de la Division 8 (Technologie de l’image). Lors du dernier congrès de la CIE à Vienne, la France figurait au 5e rang en nombre de participants, sur les 40 pays représentés, témoignant de son dynamisme et de son influence dans l’élaboration des normes et recommandations mondiales.
Que souhaitez-vous faire évoluer pour la CIE France ?
Christophe Martinsons : J’aimerais surtout voir plus d’industriels français rejoindre la CIE France. Aujourd’hui, notre comité est majoritairement composé de chercheurs et de représentants d’établissements publics. Nous avons en France des fabricants et intégrateurs de lumière ; leur présence pourrait être renforcée pour mieux échanger nos connaissances et faire avancer les travaux internationaux.
La CIE France est ouverte à tous les membres de l’Association française de l’éclairage (AFE), qui peuvent participer aux groupes de travail et apporter leur expertise. Vous êtes les bienvenus pour rejoindre cette dynamique !
Propos recueillis par Lionel Simonot lors d’un entretien en visioconférence, le 25 septembre 2025.
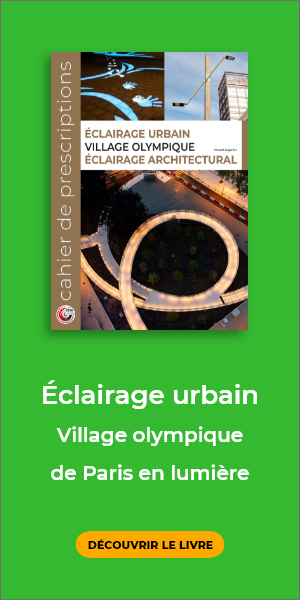
Approfondir le sujet
Photo en tête de l’article : Christophe Martinsons, Physicien au CSTB et président de la CIE France © CSTB